Effacement du seuil de Stalapos sur l’Alagnon
Créée le 31/05/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation |
| Type d'opération |
Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |
Continuité écologique |
| Début des travaux Fin des travaux |
mai 2008 octobre 2009 |
| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | Alagnon |
| Distance à la source | 15.00 km |
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |
5.00 m
|
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |
Non renseigné |
| Pente moyenne | 0.50 ‰ |
| Débit moyen | 1.00 m3/s |
| Contexte réglementaire |
Parc Naturel Régional Site inscrit |
| Autres | Cours d'eau classé |
| Loi |
Non concerné |
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau |
FRGR0247 |
| Référence du site Natura 2000 |
Non concerné |
| Code ROE |
Non renseigné |
Localisation
| Pays | France |
| Bassins |
Loire-Bretagne |
| Région(s) |
AUVERGNE |
| Département(s) |
CANTAL (15) |
| Communes(s) |
MURAT (15138) |
| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
Coûts
| Coût des études préalables | 10 400 € HT |
| Coût des acquisitions | Non renseigné |
| Coût des travaux et aménagement |
153 000 € HT
soit, au mètre linéaire : Non renseigné |
| Coût de la valorisation | Non renseigné |
| Coût du suivi | Non renseigné |
| Coût total de l’opération | 173 800 € HT |
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné |
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (40%), - conseil général (25%) - conseil régional (15%) - syndicat mixte de gestion de l’Alagnon (10%) - fédération départementale de la pêche (10%) |
| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - fédération départementale de la pêche. |
| Maître d'ouvrage |
Syndicat intercommunal de gestion de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL)
|
| Contacts | Guillaume Ponsonnaille |
|
47, rue Jean Lépine - 15500 Massiac
alagnon@wanadoo.fr |
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |
|
Référence(s) bibliographique(s)
Non renseigné
Effacement du barrage de Fatou sur la Beaume
Créée le 31/05/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation |
| Type d'opération |
Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |
Continuité écologique |
| Début des travaux Fin des travaux |
juin 2007 août 2007 |
| Linéaire concerné par les travaux | 50 m |
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | La Beaume |
| Distance à la source | 9.50 km |
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |
2.00 m
|
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |
Non renseigné |
| Pente moyenne | 37.00 ‰ |
| Débit moyen | 0.23 m3/s |
| Contexte réglementaire |
Non concerné |
| Autres |
Non concerné |
| Loi |
Non concerné |
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau |
FRGR1677 |
| Référence du site Natura 2000 |
FR8301096
|
| Code ROE |
Non renseigné |
Localisation
| Pays | France |
| Bassins |
Loire-Bretagne |
| Région(s) |
AUVERGNE |
| Département(s) |
HAUTE-LOIRE (43) |
| Communes(s) |
SOLIGNAC-SUR-LOIRE (43241) |
| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
Coûts
| Coût des études préalables | Non renseigné |
| Coût des acquisitions | Non renseigné |
| Coût des travaux et aménagement |
204 850 € HT
soit, au mètre linéaire : Non renseigné |
| Coût de la valorisation | Non renseigné |
| Coût du suivi | Non renseigné |
| Coût total de l’opération | 204 850 € HT |
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné |
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - Etat (40%) - Etablissement Public Loire (25%) - Agence de l'eau (20%) - Union européenne (15%) |
| Partenaires techniques du projet | - Électricité de France - office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - fédération départementale pour la pêche - association locale de pêche. |
| Maître d'ouvrage |
Établissement public Loire
|
| Contacts | Olivier Collon |
|
olivier.collon@eptb-loire.fr |
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |
|
Référence(s) bibliographique(s)
Non renseigné
Effacement du barrage sur l’Allier à Saint-Étienne-du-Vigan
Créée le 21/05/2010
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation |
| Type d'opération |
Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |
Continuité écologique Bon état des habitats |
| Début des travaux Fin des travaux |
octobre 1996 juin 1998 |
| Linéaire concerné par les travaux | 900 m |
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | Allier |
| Distance à la source | 44.00 km |
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |
20.00 m
|
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |
Non renseigné |
| Pente moyenne | 7.40 ‰ |
| Débit moyen | 10.50 m3/s |
| Contexte réglementaire |
Non concerné |
| Autres | Cours d'eau classé |
| Loi |
Non concerné |
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau |
FRGR0141a |
| Référence du site Natura 2000 |
Non concerné |
| Code ROE |
Non renseigné |
Localisation
| Pays | France |
| Bassins |
Loire-Bretagne |
| Région(s) |
AUVERGNE |
| Département(s) |
HAUTE-LOIRE (43) |
| Communes(s) |
SAINT-ETIENNE-DU-VIGAN (43180) |
| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Nomenclatures s'appliquant sur le site :
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
Coûts
| Coût des études préalables | 106 700 € HT |
| Coût des acquisitions | Non renseigné |
| Coût des travaux et aménagement |
1 158 600 € HT
soit, au mètre linéaire : Non renseigné |
| Coût de la valorisation | Non renseigné |
| Coût du suivi | Non renseigné |
| Coût total de l’opération | 1 270 000 € HT |
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné |
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - ministère de l’environnement - Agence de l’eau. - EDF |
| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau. |
| Maître d'ouvrage |
EDF
|
| Contacts | Pascal Bomassi |
|
Office national de l’eau et des milieux aquatiques
pascal.bomassi@onema.fr |
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |
|
Référence(s) bibliographique(s)
Mise en place d’arrêtés préfectoraux de protection de biotope sur les cours d’eau du département de l’Orne
Créée le 18/05/2010
L'opération
| Catégories | Préservation et gestion |
| Type d'opération |
Mise en place d'une protection règlementaire (arrêté de biotope, réserves volontaires…) sur les cours d'eau |
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |
Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |
| Début des travaux Fin des travaux |
décembre 1985 décembre 1985 |
| Linéaire concerné par les travaux | 79000 m |
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | 21 cours d'eau sont concernés |
| Distance à la source |
Non renseigné |
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |
Non renseigné |
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |
Non renseigné |
| Pente moyenne |
Non renseigné |
| Débit moyen |
Non renseigné |
| Contexte réglementaire |
Non concerné |
| Autres |
Non concerné |
| Loi |
Non concerné |
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau |
Non renseigné |
| Référence du site Natura 2000 |
Non concerné |
| Code ROE |
Non renseigné |
Localisation
| Pays | France |
| Bassins |
Loire-Bretagne Seine-Normandie |
| Région(s) |
BASSE-NORMANDIE |
| Département(s) |
ORNE (61) |
| Région | NORMANDIE |
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
Coûts
| Coût des études préalables | Non renseigné |
| Coût des acquisitions | Non renseigné |
| Coût des travaux et aménagement |
Non renseigné
soit, au mètre linéaire : Non renseigné |
| Coût de la valorisation | Non renseigné |
| Coût du suivi | Non renseigné |
| Coût total de l’opération | Non renseigné |
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné |
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | |
| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - direction départemental de l’agriculture et de la forêt (DDAF) - direction régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) - fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques |
| Maître d'ouvrage |
|
| Contacts | Hubert Boudet |
|
Onema – Service départemental
sd61@onema.fr |
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |
|
Référence(s) bibliographique(s)
Non renseigné
Restauration et entretien de la tourbière de Gourgon
Créée le 04/03/2010
L'opération
| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |
| Type de génie écologique | Restauration et entretien de la tourbière de Gourgon |
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |
| Début des travaux Fin des travaux |
avril 2004 septembre 2009 |
| Surface concernée par les travaux | 77.00 ha |
La zone humide dans la partie restaurée
| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |
| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |
| Type hydrogéomorphologique | Dépression |
| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |
| Autres |
Non concerné |
| Loi |
Loi montagne |
Références au titre des directives européennes
| Rattachement à une Masse d'eau |
Non concerné |
| Référence du site Natura 2000 |
FR8201756
FR8201758
FR8301030
|
Localisation
| Pays | France |
| Bassins |
Loire-Bretagne |
| Région(s) |
RHONE-ALPES |
| Département(s) |
LOIRE (42) |
| Communes(s) |
ROCHE (42188) |
Objectifs du projet et fonctions visées
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Demande de défrichement.
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
Coûts
| Coût des études | 41000 |
| Coût des acquisitions | 106000 |
| Coût des travaux et aménagement |
356000
soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |
| Coût de la valorisation | Non renseigné |
| Coût total de l’opération | 503000 |
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'Eau Loire-Bretagne |
| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire Botanqiue National du Massif Central - Entreprises de travaux |
| Maître d'ouvrage | Conseil général de la Loire
|
| Contacts | Laurent Russias |
|
Hôtel du département
2, rue Charles de Gaulle
42000 SAINT-ETIENNE
laurent.russias@cg42.fr |
Référence(s) bibliographique(s)
Gestion des ligneux sur la tourbière d’Auranchet
Créée le 26/02/2010
L'opération
| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |
| Type de génie écologique | Gestion des ligneux sur la tourbière d’Auranchet |
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives |
| Début des travaux Fin des travaux |
juillet 2006 novembre 2007 |
| Surface concernée par les travaux | 5.00 ha |
La zone humide dans la partie restaurée
| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |
| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |
| Type hydrogéomorphologique | Gestion des ligneux sur la tourbière d’Auranchet |
| Contexte réglementaire |
Non concerné |
| Autres | SDAGE Loire Bretagne |
| Loi |
Loi montagne |
Références au titre des directives européennes
| Rattachement à une Masse d'eau |
FRGR0234 FRGG049 |
| Référence du site Natura 2000 |
Non concerné |
Localisation
| Pays | France |
| Bassins |
Loire-Bretagne |
| Région(s) |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| Département(s) |
LOZERE (48) |
| Communes(s) |
ARZENC-DE-RANDON (48008) |
Objectifs du projet et fonctions visées
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Non renseigné
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
Coûts
| Coût des études |
Non renseigné |
| Coût des acquisitions |
Non renseigné |
| Coût des travaux et aménagement |
3000
soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |
| Coût de la valorisation | Non renseigné |
| Coût total de l’opération | 3000 |
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’Eau Loire-Bretagne - Conservatoire des Espaces naturels Languedoc-Roussillon - Agriculteur gestionnaire du site |
| Partenaires techniques du projet | - Office National des Forêts - Agriculteur gestionnaire du site |
| Maître d'ouvrage | Conservatoire Départemental des Sites Lozériens
 |
| Contacts | Anne Rémond |
|
5 bis impasse Félix-Remise
48000 Mende
cdsl@wanadoo.fr |
Référence(s) bibliographique(s)
Projet d’utilisation du pâturage comme mode d’entretien des milieux ouverts du lit de la Loire
Créée le 16/02/2010
L'opération
| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |
| Type de génie écologique |
Non renseigné |
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |
| Début des travaux Fin des travaux |
décembre 2006 novembre 2013 |
| Surface concernée par les travaux | 500.00 ha |
La zone humide dans la partie restaurée
| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |
| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |
| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |
| Contexte réglementaire |
Non concerné |
| Autres | site de conservatoire d'Espaces Naturels |
| Loi |
Non concerné |
Références au titre des directives européennes
| Rattachement à une Masse d'eau |
FRG0007a FRG000c |
| Référence du site Natura 2000 |
FR2400528
FR2410017
|
Localisation
| Pays | France |
| Bassins |
Loire-Bretagne |
| Région(s) |
CENTRE |
| Département(s) |
LOIRET (45) |
| Communes(s) |
BAULE (45024) BEAUGENCY (45028) BEAULIEU-SUR-LOIRE (45029) BONNY-SUR-LOIRE (45040) BOU (45043) BRIARE (45053) CHAINGY (45067) CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA) (45075) CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45082) CHATILLON-SUR-LOIRE (45087) CHECY (45089) COMBLEUX (45100) DAMPIERRE-EN-BURLY (45122) DRY (45130) GERMIGNY-DES-PRES (45153) GIEN (45155) GUILLY (45164) JARGEAU (45173) LAILLY-EN-VAL (45179) LION-EN-SULLIAS (45184) MARDIE (45194) MAREAU-AUX-PRES (45196) MEUNG-SUR-LOIRE (45203) NEVOY (45227) ORLEANS (45234) OUSSON-SUR-LOIRE (45238) OUVROUER-LES-CHAMPS (45241) OUZOUER-SUR-LOIRE (45244) POILLY-LEZ-GIEN (45254) SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD (45268) SAINT-AY (45269) SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE (45270) SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE (45271) SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL (45273) SAINT-DENIS-EN-VAL (45274) SAINT-FIRMIN-SUR-LOIRE (45276) SAINT-GONDON (45280) SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN (45282) SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45284) SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45285) SAINT-JEAN-LE-BLANC (45286) SAINT-MARTIN-SUR-OCRE (45291) SAINT-PERE-SUR-LOIRE (45297) SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN (45298) SANDILLON (45300) SIGLOY (45311) SULLY-SUR-LOIRE (45315) TAVERS (45317) |
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Non renseigné
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
Coûts
| Coût des études |
Non renseigné |
| Coût des acquisitions |
Non renseigné |
| Coût des travaux et aménagement |
Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |
| Coût de la valorisation | Non renseigné |
| Coût total de l’opération |
Non renseigné |
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - - DREAL Centre - - Conseil Régional du Centre - - FEADER – mesure 323D4 du DRDR Centre |
| Partenaires techniques du projet | - - DDT du Loiret, Service Loire - - Syndicat Ovin - -. DDT du Loiret, services nature et économie agricole |
| Maître d'ouvrage | Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre
 |
| Contacts | Chambre d’Agriculture du Loiret (Co-pilotage) |
|
30 rue Bretonnerie
45000 Orléans
siege.orleans@conservatoire-espacesnaturels-centre.org |
Référence(s) bibliographique(s)
Non renseigné
Travaux de reméandrage sur le ruisseau de Mardereau
Créée le 30/12/2009
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation |
| Type d'opération |
Reméandrage |
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |
Bon état des habitats Qualité de l’eau |
| Début des travaux Fin des travaux |
février 2009 février 2009 |
| Linéaire concerné par les travaux | 230 m |
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | Le Mardereau |
| Distance à la source | 1.00 km |
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |
2.50 m
|
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |
Non renseigné |
| Pente moyenne | 0.08 ‰ |
| Débit moyen |
Non renseigné |
| Contexte réglementaire |
Non concerné |
| Autres |
Non concerné |
| Loi |
Non concerné |
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau |
FRGR2158 |
| Référence du site Natura 2000 |
Non concerné |
| Code ROE |
Non renseigné |
Localisation
| Pays | France |
| Bassins |
Loire-Bretagne |
| Région(s) |
CENTRE |
| Département(s) |
INDRE-ET-LOIRE (37) |
| Communes(s) |
SORIGNY (37250) |
| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
Coûts
| Coût des études préalables | Non renseigné |
| Coût des acquisitions | Non renseigné |
| Coût des travaux et aménagement |
19 000 € HT
soit, au mètre linéaire : 82 |
| Coût de la valorisation | Non renseigné |
| Coût du suivi | Non renseigné |
| Coût total de l’opération | 19 000 € HT |
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné |
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - Syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée de l’Indre (100%)) |
| Partenaires techniques du projet | - Onema délégation interrégionale Centre - Poitou-Charentes - Direction départementale de l’agriculture et des forêts |
| Maître d'ouvrage |
Le Syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée de l’Indre (SAVI)
|
| Contacts | David Laurendeau |
|
mairie de Pont de Ruan 37260 PONT-DE-RUAN
synd_amenagement_indre_affluents@yahoo.fr |
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |
|
Référence(s) bibliographique(s)
Gestion adaptative des ouvrages hydrauliques de la Sèvre Nantaise et du Thouet
Créée le 30/12/2009
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation |
| Type d'opération |
Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |
Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats |
| Début des travaux Fin des travaux |
|
| Linéaire concerné par les travaux |
Non renseigné |
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | La Sèvre Nantaise |
| Distance à la source |
Non renseigné |
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |
Non renseigné |
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |
Non renseigné |
| Pente moyenne | 1.54 ‰ |
| Débit moyen | 8.00 m3/s |
| Nom | |
| Distance à la source |
Non renseigné |
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |
Non renseigné |
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |
Non renseigné |
| Pente moyenne |
Non renseigné |
| Débit moyen |
Non renseigné |
| Longueur |
Non renseigné |
| Contexte réglementaire |
Non concerné |
| Autres |
Non concerné |
| Loi |
Non concerné |
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau |
FRGR0547a FRGR0548 FRGR0547b |
| Référence du site Natura 2000 |
FR5400442
|
| Code ROE |
Non renseigné |
Localisation
| Pays | France |
| Bassins |
Loire-Bretagne |
| Région(s) |
PAYS DE LA LOIRE |
| Département(s) |
LOIRE-ATLANTIQUE (44) MAINE-ET-LOIRE (49) VENDEE (85) |
| Région | PAYS DE LA LOIRE |
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
Non concerné
La gestion
Non renseigné
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
Coûts
| Coût des études préalables | Non renseigné |
| Coût des acquisitions | Non renseigné |
| Coût des travaux et aménagement |
Non renseigné
soit, au mètre linéaire : Non renseigné |
| Coût de la valorisation | Non renseigné |
| Coût du suivi | Non renseigné |
| Coût total de l’opération | Non renseigné |
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné |
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau - conseils régionaux - fonds structurels européens LEADER+ |
| Partenaires techniques du projet | - Université de Nantes (Régis Barraud) - GEOLITTOMER |
| Maître d'ouvrage |
Syndicat mixte de la vallée du Thouet, Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre nantaise
 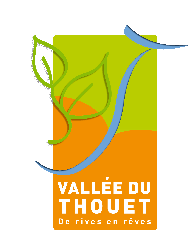 |
| Contacts | Antoine Charrier & Olivier Constantin |
|
Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre nantaise (IIBSN)
Syndicat mixte de la vallée du Thouet (SMVT)
smvt@valleeduthouet.fr
acharrier@sevre-nantaise.com |
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |
|
Référence(s) bibliographique(s)
Effacement du plan d’eau de Coupeau sur le Vicoin et réaménagement du lit mineur
Créée le 21/12/2009
L'opération
| Catégories | Restauration et réhabilitation |
| Type d'opération |
Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |
| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |
| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |
Continuité écologique |
| Début des travaux Fin des travaux |
avril 2008 octobre 2010 |
| Linéaire concerné par les travaux | 800 m |
Cours d'eau dans la partie restaurée
| Nom | Le Vicoin |
| Distance à la source | 28.00 km |
| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |
10.00 m
|
| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |
Non renseigné |
| Pente moyenne | 2.00 ‰ |
| Débit moyen | 1.90 m3/s |
| Contexte réglementaire |
Non concerné |
| Autres |
Non concerné |
| Loi |
Non concerné |
Références au titre des directives européennes
| Référence de la Masse d'eau |
FRGR0517 |
| Référence du site Natura 2000 |
Non concerné |
| Code ROE |
Non renseigné |
Localisation
| Pays | France |
| Bassins |
Loire-Bretagne |
| Région(s) |
PAYS DE LA LOIRE |
| Département(s) |
MAYENNE (53) |
| Communes(s) |
SAINT-BERTHEVIN (53201) |
| Région | PAYS DE LA LOIRE |
Les objectifs du maître d'ouvrage
Le milieu et les pressions
Les opportunités d'intervention
Les travaux et aménagements
La démarche réglementaire
La gestion
Le suivi
Le bilan et les perspectives
La valorisation de l'opération
Coûts
| Coût des études préalables | 61 210 € HT |
| Coût des acquisitions | Non renseigné |
| Coût des travaux et aménagement |
443 135 € HT
soit, au mètre linéaire : 554 |
| Coût de la valorisation | 16 720 € HT |
| Coût du suivi | Non renseigné |
| Coût total de l’opération | 521 065 € HT |
Témoignage
| Existence d'un témoignage | |
| Témoignage | Non renseigné |
Partenaires et maître d'ouvrage
| Partenaires financiers et financements | - agence de l'eau (40%) - conseil général (13%) - conseil régional (6%) - ministère de l'intérieur (pour les aménagements récréatifs et touristiques) 6% - syndicat du bassin du vicoin (1%) |
| Partenaires techniques du projet | - Onema service départemental - Direction régionale de l’environnement (DIREN) - Direction départementale de l’agriculture et des forêts (DDAF) - Fédération départementale de la pêche |
| Maître d'ouvrage |
Commune de Saint-Berthevin
 |
| Contacts | Evelyne Avril |
|
Mairie de Saint-Berthevin
Place de l’Europe - BP 4255 - 53 942 SAINT-BERTHEVIN Cedex
evelyne.avril@ville-saint-berthevin.fr |
| Maître d'ouvrage | |
| Contacts |
|
Référence(s) bibliographique(s)
Non renseigné

 Espace perso
Espace perso Contact
Contact Glossaire
Glossaire
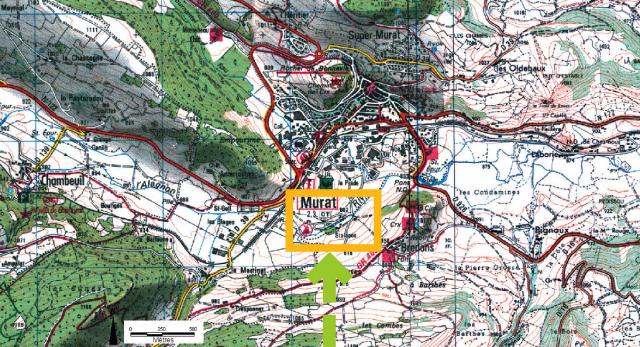


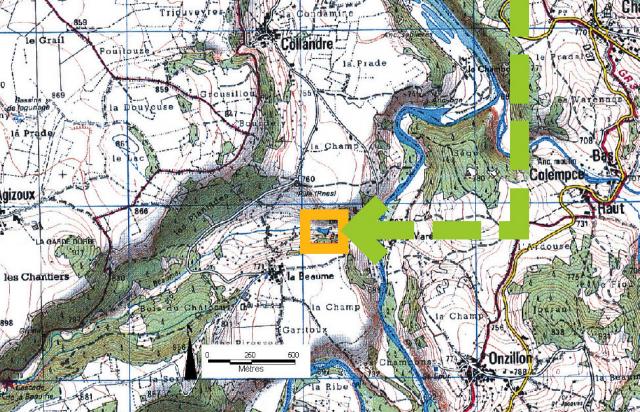



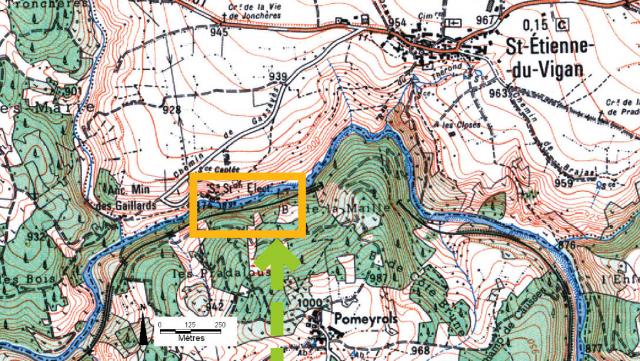



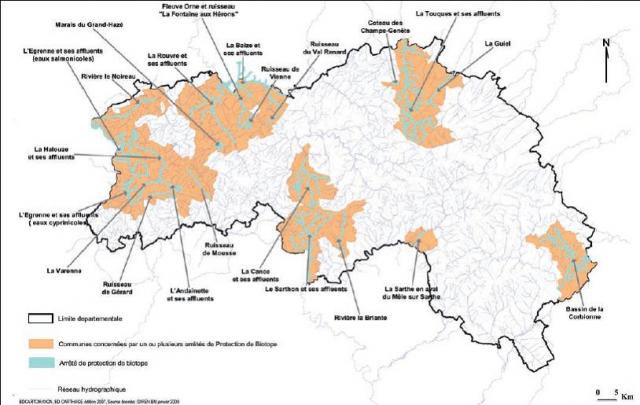



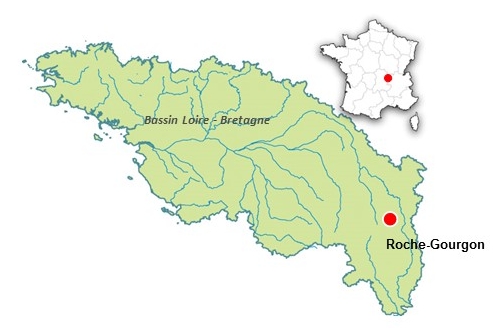
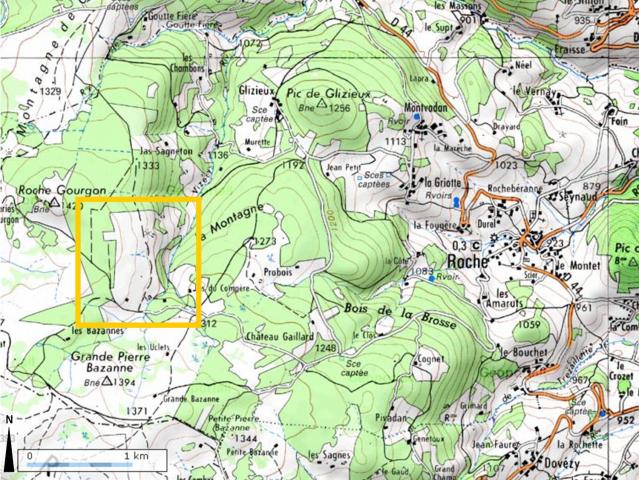




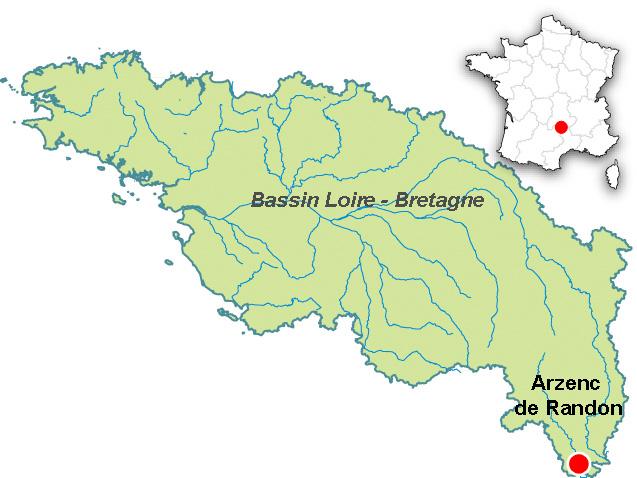
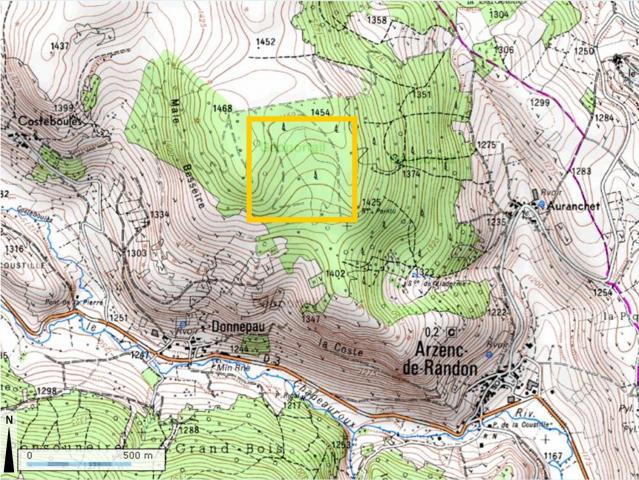


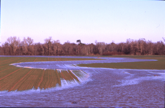


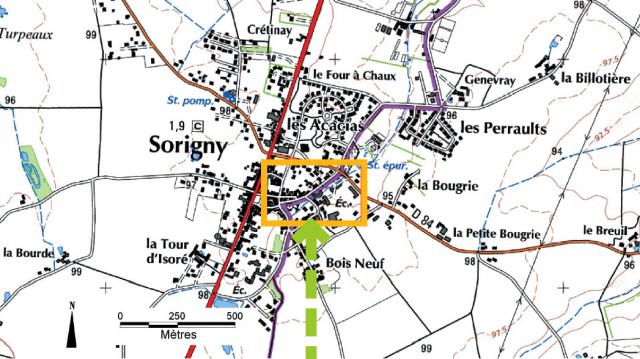
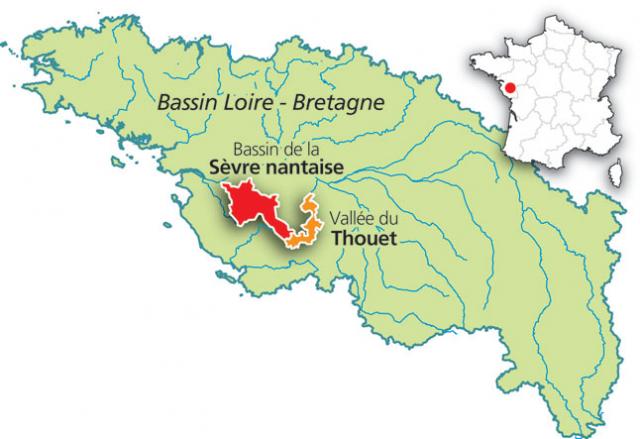




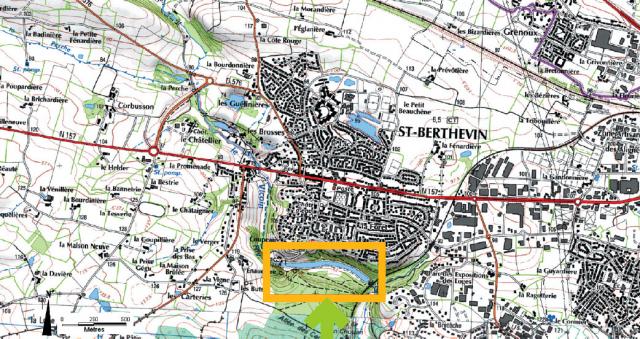



 RSS
RSS

